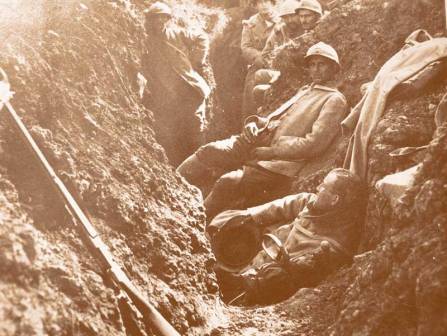14-18, la résistance de « l’abri des pèlerins »
Une ferme appelée la ferme du Thiaumont, un lieu d’hébergement des ouvriers qui ont construit l’Ossuaire de Douaumont (nécropole inauguré en 1932, afin d’offrir une sépulture décente aux soldats tombés à Verdun pendant la Guerre de 14-18), une aumônerie. Ce sont les nombreuses transformations que le café-restaurant « l’abri des pèlerins » a connues depuis la Grande Guerre jusqu’ à nos jours.
Situé sur le champ de bataille, il a une architecture anglo-normande avec des fenêtres guillotines, des murs en petites briques grises. A l’intérieur, les chaises et les tables disposées de façon rectangulaire. Tout est calme, aucune musique, même pas en fond sonore. Tout est fait pour ne pas troubler le sommeil des morts. Le nom de ce café-restaurant « l’abri des pèlerins » en dit long sur l’ambiance qui y règne. « Autrefois, il accueillait les pèlerins qui venaient sur les traces de leurs familles disparues », raconte la propriétaire Sylvaine Vaudron. C’est comme si le vent de tranquillité et de recueillement du cimetière militaire soufflait jusque dans cet espace. On a l’impression d’y communier avec ces milliers de soldats couchés sous des croix blanches à quelques centaines de mètres de là. De vieilles photos en blancs et noires du village de Douaumont sont accrochées aux murs. Au-dessus du bar, les drapeaux français, américain, allemand, italien, suisse, européen sont plantés dans un pot. Symbole et souvenirs du passage de citoyens du monde. Madame Vaudron tient à préserver la sérénité et le respect qui caractérise ce lieu hautement historique et symbolique de la Première Guerre Mondiale.
« Je préfère être ici qu’à Verdun. L’aspect très calme, on a les petits oiseaux qui nous réveillent le matin on n’a pas l’impression d’être dans un lieu triste. Le passé de Douaumont est très lourd, mais on est en même temps dans un cadre de vie unique. C’est empreint de beaucoup de recueil. Quand les gens viennent ici, ils sont calmes, on ressent un certain respect face à ce cimetière à ciel ouvert. C’est pour cette raison que dans le restaurant, nous ne mettons pas de musique. C’est une volonté personnelle de notre part pour que les gens, quand ils rentrent chez nous, ils continuent de réfléchir à ce qu’ils viennent de voir. Qu’ils se rendent compte de la fragilité du monde dans lequel nous vivons. »
Un village mort, huit habitants
Plus de 10 ans que la famille Vaudron a quitté Domrémy-la-Pucelle (Les vosges) pour reprendre le restaurant. Il était géré auparavant par Marie-Claude Minmeister, maire sortante de Douaumont, l’un des 9 villages dits « morts pour la France » et l’un des trois où il reste encore de la vie humaine malgré le nombre très réduit de ses habitants. Ils sont en effet huit personnes qui habitent Douaumont. La Famille de Sylvaine Vaudron et la famille d’Olivier Gérard, le directeur de l’Ossuaire. Lors des élections municipales le dimanche 23 mars dernier comme dans toutes les communes en France, les habitants ont voté. Scénario inimaginable, six électeurs ont voté pour les six candidats. Résultats, on connaissait déjà la composition du conseil municipal de Douaumont.
Le frère de la propriétaire de « l’abri des pèlerins », Richard Enrici ne cache pas non plus son sentiment de vivre dans un village de moins de 10 habitants. Il a longtemps vécu à Paris avant de rejoindre sa sœur à Douaumont pour profiter « d’une vie tranquille loin des grandes villes. » Et sa sœur s’est laissée aller dans le récit d’une expérience vécue avec sa petite-fille.
« Je suis ravie d’être là, pour rien au monde je laisserais ma place. J’ai cinq petits-enfants. Quand ils viennent ils me disent mamy tu viens on va aller voir la guerre ? Pour eux c’est comme un jeu. Un jour je me promenais avec ma petite fille de 8 ans qui ne savait pas encore bien lire. Elle me demandait ce qui était écrit sur les croix. Je lui expliquais que c’est le nom d’un soldat, et c’est marqué mort pour la France. Elle a posé sa main sur le côté de la croix et fièrement, elle a dit mort pour la France. Elle passe à la deuxième ligne, elle remet la main, mort pour la France. Elle m’a fait toute la ligne comme ça, mais vraiment avec un respect que j’en étais émue. J’en ai encore des frissons. Elle est petite mais elle a compris qu’ils sont morts pour notre pays. »
Kpénahi Traoré